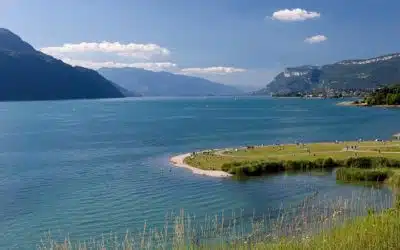Voici une route qui ne se contente pas de relier deux vallées : elles racontent une histoire, murmurent un mythe, sculptent le paysage de l’âme alpine. La route du col de l’Iseran, entre Bourg-Saint-Maurice et Modane, est de celles-là. À 2764 mètres, l’Iseran est le plus haut col routier des Alpes françaises, et il fait franchir non seulement une barrière géographique, mais aussi une frontière invisible entre deux mondes : la Tarentaise et la Maurienne, la Savoie de l’eau et la Savoie du roc.
De Bourg-Saint-Maurice à Val d’Isère : la Haute-Tarentaise le long de l’Isère
Bourg Saint Maurice, ville entourée de cols fermés en hiver
La route débute à Bourg-Saint-Maurice, que les locaux appellent affectueusement Bourg, car c’est bien là qu’a toujours battu le cœur de la haute Tarentaise. Cité ancienne, poste stratégique sur la voie romaine des Alpes, en Haute Tarentaise, Bourg fut longtemps un lieu de contrôle et de passage. À la confluence de l’Isère et de plusieurs routes transalpines, elle fut successivement carrefour commerçant, ville frontière sous le duché de Savoie, et poste militaire à l’époque sarde, avant de devenir ce qu’elle est aujourd’hui : un pivot touristique et ferroviaire, porte d’accès aux plus grandes stations de la région.
La vieille ville conserve des vestiges précieux : des ruelles pavées bordées de façades de pierre, la tour de Rochefort, quelques maisons patriciennes aux linteaux sculptés, et l’église Saint-Maurice, au clocher roman dont les pierres racontent l’âge médiéval. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Bourg-Saint-Maurice joua un rôle de verrou dans la défense des Alpes, et l’on devine encore, derrière la sérénité actuelle, les traces invisibles des lignes de repli, des souterrains et des cantonnements.
La route quitte la ville pour s’élever le long de l’Isère, au fil de vallées creusées par les glaciers, où se mêlent alpages verdoyants et forêts d’épicéas. Sur la droite, c’est le Mont Pourri, toisant la vallée du haut de ses 3779 mètres. Son nom, qui intrigue toujours, vient de l’ancien mot savoyard « pourrier » — le roc friable — et non d’une quelconque mauvaise réputation. Face à lui, les dômes de la Vanoise barrent l’horizon comme un rempart naturel.

Tignes, histoire d’un village déplacé d’un lac à un autre
Un peu plus haut, le paysage change : vous arrivez à l’ancien site de Tignes, ou plutôt, à ce qu’il en reste. Car le village originel de Tignes n’existe plus : il repose désormais sous les eaux. En 1952, l’État français lance la construction du barrage de Tignes, une prouesse d’ingénierie hydroélectrique, mais une décision douloureuse pour les habitants. Le vieux village est englouti, une vierge en béton est coulée dans le lac, et les familles relogées plus haut. Aujourd’hui, le lac du Chevril reflète dans ses eaux turquoises la silhouette du Mont-Blanc lointain, et une immense fresque de Hercule de 90 mètres de haut, peinte sur le mur du barrage en 1989 par Jean-Marie Pierret, domine la vallée, telle une sentinelle mythologique. Aujourd’hui, la moderne station de Tignes accueille ses visiteurs au bord du lac de Tignes, gelé cinq mois par an dans un décor de blancheur absolue.
Val d’Isère, ancien village d’altitude transformé en station luxueuse
La route contourne le lac, longe le hameau du Chevril, avant d’atteindre les hauteurs de Val d’Isère, station mondialement connue, mais dont l’histoire remonte bien avant le ski. À l’origine, Val d’Isère est un village de bergers et de passeurs, accroché à une vallée rude, battue par les vents, à la lisière du col de l’Iseran. L’église Saint-Bernard-de-Menthon, patron des montagnards et des voyageurs, en témoigne : elle fut bâtie pour offrir un refuge spirituel à ceux qui osaient franchir le col, jadis difficile et périlleux.
Aujourd’hui, au-delà des chalets modernes et des téléphériques, l’âme de Val d’Isère subsiste dans ses hameaux anciens, ses ruelles de pierre, et dans le murmure de l’Isère qui dévale les gorges. À partir d’ici, la route cesse d’être simple voie d’accès : elle devient chemin d’altitude, défiant les cieux, en quête de lumière et de silence.

La montée au col de l’Iseran : l’aventure pour les cyclistes
Du hameau du Fornet au col de l’Iseran
À la sortie de Val d’Isère, la route s’élève en pente douce vers le Fornet, dernier hameau habité avant les hauteurs. Ce village paisible, lové au creux d’une clairière, déploie encore ses chalets authentiques, faits de pierre blonde et de bois ancien. Les greniers sur pilotis, appelés mazots, les fontaines sculptées, les murets de pierres sèches évoquent une vie montagnarde ancestrale, rythmée par les saisons et la transhumance.
Très vite, l’asphalte s’engage dans un univers minéral, celui des gorges du Malpasset, dont le nom dit bien la rudesse : c’est ici que, jadis, les voyageurs affrontaient les chutes de pierres, les avalanches tardives, les rafales de vent venues des glaciers. La route ne les traverse pas, elle les laisse sur le côté gauche après le Pont Saint-Charles. Un vieux pont de pierre, dressé au-dessus de l’Isère vive, marque le passage vers les hauteurs : un seuil entre deux mondes. Les bergers d’antan y faisaient halte. Aujourd’hui, les cyclistes y reprennent leur souffle, les marcheurs s’y émerveillent, les marmottes y sifflent à l’ombre des rochers.
Ensuite, chaque virage dévoile un peu plus le royaume du haut : prairies suspendues, névés éternels, éboulis mouvants, mélèzes solitaires accrochés comme par miracle.
La montée se poursuit en lacets réguliers, balisés par des bornes anciennes, vestiges du chantier titanesque entrepris dans les années 1930. La route du col de l’Iseran fut inaugurée en 1937, fruit d’un projet stratégique et touristique soutenu par l’État et le Touring Club de France. À travers ce tracé, on voulait relier deux grandes vallées, mais aussi affirmer la présence française sur les crêtes, face à une Italie fasciste menaçante. La chaussée fut dessinée dans le respect du relief, sans viaduc ni tunnel : un trait d’ardoise épousant la montagne, à la manière d’un sentier de géant.

Le col de l’Iseran : au-dessus des frontières
Enfin, le col apparaît. À 2764 mètres d’altitude, une chapelle de pierre grise, sobre et trapue, s’élève face au vide. Dédiée à Notre-Dame-de-toute-Prudence, elle fut construite à la même époque que la route, pour protéger les voyageurs et les ouvriers des hauteurs. Ici, le silence est roi. Seul le vent s’autorise à parler fort, portant les cris des rapaces et le craquement lointain des glaciers. Sauf lorsque la foule se masse au passage des coureurs du Tour de France !
Le paysage est lunaire, strié de blocs de gneiss, de plaques de neige résiduelle, et de lacs temporaires formés par la fonte. On aperçoit les dômes de la Vanoise, le mont du Grand Fond, et, par temps clair, le Grand Paradis italien, cousin alpin de ces terres frontières. Des vestiges de baraquements militaires subsistent, éparpillés comme des pierres tombales de granit, témoignant du temps où l’Iseran était aussi un poste de guet stratégique, entre Savoie française et Piémont italien.
Et pourtant, malgré sa hauteur, l’Iseran n’est pas une frontière. C’est un passage, une ouverture, un appel vers l’ailleurs. Comme l’écrivait Roger Frison-Roche :
« À l’Iseran, on ne regarde pas la montagne : on regarde à travers elle, comme on regarde à travers une fenêtre ouverte sur l’infini. »
Dans son Journal de montagne, Samivel écrivait : « L’Iseran, c’est le lieu où le silence devient matière, et le ciel, territoire à gravir. »
La descente de l’Iseran à Modane
La descente vers Bonneval sur Arc
Dès le col franchi, la route plonge dans un univers brut, sauvage, farouchement alpin. Le versant mauriennais de l’Iseran est plus abrupt, plus âpre que son pendant tarin. Ici, pas de village avant longtemps, pas de douceur immédiate : la montagne règne sans partage.
Les premiers lacets descendent à flanc de montagne, découpant le relief comme un fil dans le tissu d’ardoise. Les versants sont striés par les ravines, creusés par les avalanches, hérissés de blocs erratiques abandonnés par les anciens glaciers. La lumière y est tranchante, quasi minérale, sculptant les reliefs à l’aube et les noyant d’ombre dès l’après-midi.
Très vite, dans un replat lové au pied des parois, surgit Bonneval-sur-Arc. Classé parmi les plus beaux villages de France, ce joyau suspendu au bord du silence a miraculeusement échappé aux dénaturations modernes. Les maisons sont en pierres sèches, les toits en lauze épaisses, les chemins pavés, les abreuvoirs de granite encore utilisés. Pas de fils électriques visibles, pas de béton criard : ici, tout semble inscrit dans la continuité des siècles.
Le village est un modèle d’architecture alpine. Les greniers sur pilotis, les baraccas, les portes basses sculptées, tout témoigne d’une vie rude, mais organisée. L’église Notre-Dame-de-l’Assomption, modeste en apparence, recèle un mobilier baroque d’une grande finesse, avec ses retables en bois doré, ses fresques et ses statues de procession, portées autrefois dans les cols pour chasser l’orage.
Depuis Bonneval, plusieurs sentiers mènent vers les hauteurs :
– Le hameau de l’Écot, intact, figé dans le temps, accessible à pied ou à vélo par un chemin bucolique longeant les gorges.
– Le refuge du Carro, dans l’univers des névés et des bouquetins, accessible aux randonneurs aguerris.
– Ou encore la route de l’Iseran, que certains courageux gravissent à vélo depuis Bonneval, s’offrant un défi mythique.

Vers Bessans : le village des diables… en bois
En quittant Bonneval, la route s’élargit légèrement, suit la courbe de l’Arc qui descend, sauvage et clair. On longe les alpages de la Duis, où les tarines paissent en liberté, et les torrents forment des cascades mousseuses sur les dalles rocheuses. Au loin, le sommet de la Bessanèse se découpe en toile de fond, ciselé comme un temple tibétain.
Puis, à 1750 mètres d’altitude, apparaît Bessans, village d’âmes fortes et d’imaginaire puissant. Ici, tout parle à la fois de religion, de mythe et de rudesse. On y vénère encore les diables de Bessans, petites figures de bois, mi-protectrices, mi-burlesques, nées d’une querelle entre curé et sacristain au XIXe siècle. Elles ornent aujourd’hui les balcons, les fontaines, les coins de chemin — gardiens silencieux de l’hiver et du rêve.
L’église Saint-Jean-Baptiste, avec son clocher à bulbe et ses fresques restaurées, trône au cœur du bourg. Autour d’elle, le musée d’art sacré, la chapelle Saint-Antoine et le vieux cimetière témoignent d’un passé spirituel foisonnant, où le catholicisme populaire s’imbrique aux croyances anciennes.
Mais Bessans est aussi un sanctuaire naturel. En quelques pas, on atteint le vallon d’Avérole, domaine du silence, où les sentiers mènent jusqu’au refuge, aux pieds des glaciers. Là, la nature est intacte. Les moraines racontent le retrait des glaces. Les gypaètes volent en spirale. Et le promeneur comprend soudain qu’il marche dans un monde qui ne demande rien, sinon d’être regardé.
De Val Cenis à Modane : entre mémoire de pierre et forêts profondes
La route quitte Bessans comme on descend d’un sanctuaire. L’air se réchauffe, les pentes s’adoucissent. Très vite, la vallée s’ouvre, large et lumineuse, en direction de Val Cenis, vaste commune née du regroupement des villages historiques de Termignon, Lanslebourg et Lanslevillard. Ici, chaque bourg conserve sa personnalité propre, façonnée par des siècles d’histoire et de luttes d’altitude.
À Lanslevillard, l’église Saint-Michel déploie un magnifique retable baroque doré, témoin d’une spiritualité enracinée. Le cimetière, ouvert sur les crêtes, est un lieu de silence et d’hommage. Plus haut, les hameaux perchés de Chantelouve et du Collet offrent une vue plongeante sur la vallée, entre alpages et pins cembros.
À Lanslebourg, au bord de l’Arc, on découvre l’église Saint-Sébastien, dont les fresques intérieures évoquent les grandes scènes de la Bible dans une palette vive. Les ruelles pavées, les encadrements de porte sculptés, les maisons à arcades rappellent le passé commerçant de cette étape du Mont-Cenis, jadis carrefour de muletiers et de diplomates.
Puis vient Termignon, à la confluence de l’eau et de la pierre. On y admire les fours communautaires encore en activité, les chapelles rustiques, et surtout les sentiers vers la Turra ou le Plan du Lac, véritables balcons sur le massif de la Vanoise. L’été, les cascades grondent, les troupeaux montent, les marmottes se dressent. L’hiver, le silence retombe comme un manteau.

Les forts de l’Esseillon : pierre contre pierre
En quittant Val Cenis, la vallée devient plus étroite, plus encaissée. Elle se resserre soudain dans une gorge abrupte où se dresse l’un des ensembles les plus impressionnants du patrimoine militaire alpin : les forts de l’Esseillon.
Accrochés aux deux rives du canyon, ils furent construits au début du XIXe siècle par le royaume de Sardaigne pour barrer l’accès à l’Italie. Le fort Marie-Christine, le fort Charles-Félix, le fort Victor-Emmanuel : autant de noms monarchiques posés comme des pierres d’échiquier. À flanc de falaise, galeries, casemates, poudrières et corps de garde dessinent un réseau défensif remarquable, parfois inachevé, souvent réutilisé, jamais inutile à contempler.
Aujourd’hui, certains de ces forts sont restaurés et ouverts à la visite. On y découvre des expositions sur la vie militaire en montagne, mais surtout des panoramas spectaculaires sur les gorges, les crêtes, et les villages en contrebas. Les plus aventureux suivront les passerelles suspendues ou les sentiers militaires tracés à la main, dans les à-pics.
Modane : entre terre, tunnel et temps de guerre
Dernier virage, dernière ligne droite. Modane apparaît dans un creux de vallée, à la fois industrielle et secrète, souvent méconnue, toujours traversée. Depuis 1871, elle est l’un des grands points d’entrée dans la France alpine : le tunnel ferroviaire du Fréjus, percé sous la montagne, en a fait une ville de passage, douanière, logistique, et, parfois, oubliée.
Mais Modane cache des trésors :
L’église Notre-Dame-de-l’Assomption, reconstruite après les bombardements de 1944, aux vitraux modernes qui racontent la paix retrouvée et le fort du Replaton, dominant la ville, relié autrefois au fort Saint-Gobain par des galeries souterraines.
La route touche à sa fin. Elle vous a fait franchir des cols, côtoyer des glaciers, traverser des siècles. À travers les cimes, les pierres et les clochers, c’est toute une civilisation alpine qui s’est révélée : faite de passages, de résistances, de beauté. Une route, ici, n’est jamais une ligne droite : c’est une mémoire en lacets.
Ces articles pourraient aussi vous intéresser:
Cinq idées de balades faciles au cœur des Bauges
A travers les vallons boisés des Bauges ou le long de crêtes aux panoramas extraordinaires, invitation dans cette magnifique région alpine.
Les six sites les plus inspirants en Savoie
Découvrez six des plus inspirants sites de Savoie au coeur des montagnes, là où le travail des Hommes rejoint l’infini du ciel.
Cinq régions des Alpes françaises à découvrir en train
Découvrez cinq belles régions des Alpes françaises facilement accessibles en train. Descendez dans votre gare et profitez de la montagne!
Les plus beaux cols des Alpes : Col du Galibier et du Lautaret
De la Maurienne à Briançon, franchissez Galibier et Lautaret entre forteresses, villages alpins et paysages sublimes.
Que visiter en Maurienne : histoire, forts, cols et vallées sacrées
Visitez la vallée de la Maurienne: celle des forts, des pèlerins et des glaciers. Un voyage entre géopolitique et mémoire alpine.
Itinéraire dans les Alpes entre France et Italie : Cols du Mont Cenis et de Montgenèvre
Entre Mont-Cenis et Montgenèvre suivez une route millénaire entre cols stratégiques, forts oubliés et cités alpines chargées d’histoire.
Ski de printemps : où skier en avril dans les Alpes en France
Skier au mois d’avril dans les Alpes françaises est encore possible. Voici les stations où vous pratiquerez le meilleur ski de printemps!
Mes articles sur le patrimoine et l’histoire des Alpes
Retrouvez ici tous les articles que j’ai rédigés sur l’histoire des Alpes et de la Maison de Savoie sur le média « Nos Alpes »
Est-ce qu’on skie bien à Val Cenis ?
La station de ski de Val Cenis, en Haute-Maurienne déploie son domaine entre cimes et forêts en face des sommets de la Vanoise.
Le plus belles pistes de ski à La Toussuire dans le domaine skiable des Sybelles
Il existe un grand domaine skiable dont on parle moins souvent : les Sybelles. La station de ski de La Toussuire en est sa station principale, par sa taille et son altitude. Il s’agit du quatrième domaine skiable français, avec plus de 300 kilomètres de pistes:…
Les Arcs: les plus belles pistes de ski de son domaine skiable
La station de ski des Arcs permet aux skieurs de tous les niveaux de s’amuser entre des tracés en forêt et des pistes rapides et sportives.
Faire du ski à Valmorel et Saint François Longchamp
Faire du ski à travers le col de la Madeleine entre Valmorel et Saint François Longchamp. J’ai testé le Grand Domaine.
Faire du ski aux Saisies et sur l’Espace Diamant
J’ai testé le domaine skiable des Saisies et de l’Espace Diamant: forêts, paysages bucoliques et Mont Blanc!
Les plus belles pistes de la station de ski de La Plagne
Le domaine skiable de La Plagne permet de skier toute la journée au soleil grâce aux expositions variées des pistes. Pur bonheur.
Le domaine skiable de Valmeinier et Valloire
Le ski à Valmeinier et Valloire permet de découvrir la région du Galibier et du Thabor. Grands espaces, pentes ensoleillées. On skie heureux.
Le top 10 des pistes de ski à Val d’Isère
AlpAddict a testé pour vous le domaine skiable de Val d’Isère. Des pistes longues, rapides et sportives mais aussi des secteurs plus cool.
Les plus belles pistes de ski de Val Thorens, plus haute station d’Europe
Le ski à Val Thorens c’est le ski sur de longues pistes et de grands dénivelés. Bien enneigée, la station fait le bonheur des skieurs.
Les meilleures pistes de ski de Tignes
AlpAddict a testé le domaine skiable de Tignes. Univers blanc entre 1500 et 3400 mètres, relié à Val d’Isère. Un bonheur pour les skieurs.
Tous les plus beaux sites du Beaufortain
Découvrir le Beaufortain, c’est découvrir la vie traditionnelle dans les Alpes. Une nature sauvage dans un cadre somptueux.
Les plus beaux villages pour les vacances en Haute Tarentaise
La Haute Tarentaise, c’est le royaume des stations de ski d’altitude en Savoie. De vastes domaines skiables avec vue sur le Mont Blanc!
Les plus beaux sites pour admirer la beauté sauvage de la vallée de la Maurienne
Un séjour en Maurienne est un séjour en pleine nature au contact de l’histoire des Alpes. Destination idéale pour les amoureux des Alpes.
Les plus beaux sites à admirer à Aix les Bains et sur les rives du lac du Bourget
Le lac du Bourget, le plus grand des lacs français, mais aussi le plus poétique. Découvrez sur ses rives de beaux sites historiques.
Les plus belles idées de découverte autour des lacs de Paladru et d’Aiguebelette
Entre Lyon et les Préalpes, les lacs d’Aiguebelette, en Savoie, et de Paladru, en Isère offrent de bons moments de fraîcheur.
Sept magnifiques destinations pour découvrir la Savoie
Un séjour en Savoie, terre de montagne, glaciers et patrimoine alpin est une opportunité excitante de découvrir de magnifiques paysages.
Les desserts de Noël dans les Alpes
Découvrez les desserts servis sur les tables à Noël dans les Alpes. Du sucre mais beaucoup de symboles aussi!
Où peut-on faire du ski dans les Alpes en novembre ?
Skier dès le mois de novembre dans les Alpes, c’est possible! AlpAddict vous présente les stations de ski ouvertes.
Où admirer le feuillage d’automne dans les Alpes françaises
L’automne dans les Alpes est féérique. C’est le moment d’aller admirer le feuillage d’automne dans les massifs français. Suivez le guide.
Trois bonnes raisons de découvrir les Pays de Savoie
Des vallées profondes, des cimes enneigées et des lacs sublimes et raffinés: découvrez les Pays de Savoie avec AlpAddict.
Cinq bonnes raisons de visiter Chambéry
Facile d’accès, Chambéry est en toute saison une des portes des Alpes. Ce n’est pas seulement une étape, mais c’est une vraie destination à part entière. AlpAddict vous emmène découvrir Chambéry, la capitale de la Savoie.
Comment aller au ski en train dans les Alpes françaises
Partir en vacances au ski en train jusqu’à votre destination finale dans les Alpes françaises. Plus de bouchons, plus de route enneigée! AlpAddict vous explique où aller et comment.